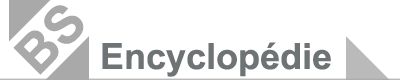|
| Reims : la cathédrale saint Remy. Façade occidentale |
Le mot « gothique » est utilisé en premier par lâitalien Giorgio Vasari en 1550 pour désigner l'art de la fin de Renaissance qui imitait l'art français du Moyen Ãge. Le terme a une connotation péjorative, car les Humanistes de la Renaissance appellent à un retour au classicisme, c'est-à -dire aux formes dépouillées et pures de l'Antiquité. Effarés par ces constructions qui ne respectent pas les canons de la période de l'Antiquité, les artistes de la Renaissance choisissent le mot « gothique » pour signifier lâorigine « barbare » de cet art, les Goths étant une ancienne peuplade germanique du Nord, dont les armées avaient envahi l'Italie et pillé Rome en 410. En fait, les Goths n'ont pris aucune part à la création de cet art qui est typiquement Français. Il vaudrait mieux l'appeler « Art ogival » ou « Opus francigenum » (art français).
Lorsqu'au XIXé naît le mouvement romantique, l'intérêt pour l'ensemble du Moyen Ãge se développe, et le mot « gothique » perd sa connotation négative. Il désigne aujourd'hui un mouvement artistique qui s'est étendu, en fonction des régions géographiques, de la première moitié du XIIé au début du XVIè.
 | | Chartres : cathédrale Notre Dame, vue générale |
|
 | | Toulouse, lâéglise des Jacobins. La célèbre voûte en palmier |
|
 | | Cambridge : le Kingâs College. Vue générale |
|
![]() Introduction
Introduction![]() « Philosophie » de lâart gothique
« Philosophie » de lâart gothique![]() Principes dâarchitecture
Principes dâarchitecture