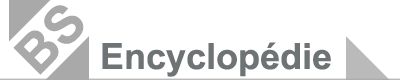La Grèce archaïque : 700-480
1. Introduction
Lâévolution politique et sociale des cités grecques pendant la période archaïque est mal connue. Née au courant du VIIIè, sans doute sur la côte ionienne, la cité regroupe un espace rural avec ses villages et un espace plus ou moins urbanisé. Son organisation sociale repose essentiellement sur la notion de « citoyen âsoldat » : en effet, les monarchies sont progressivement remplacées par des oligarchies : le pouvoir passe progressivement des princes et rois aux mains des chefs des grandes familles nobles possédant la terre, et par conséquent la richesse et les armes. Ceux-ci choisissent parmi eux des magistrats temporaires, les « archontes » à Athènes et les « éphores » à Sparte.
Mais dès les VIIè siècle et surtout au VIè siècle, cette oligarchie dâaristocrates est confrontée à de graves troubles liés à des problèmes économiques et sociaux, au premier rang desquels une véritable explosion démographique, principalement au VIIè siècle lors duquel la population aurait quadruplé⦠Cette « surpopulation » relative au pour effet dâune part lâintensification de la colonisation qui elle-même donne naissance à une classe marchande aisée réclamant bientôt, contre lâoligarchie, des droits politiques et dâautre part accroît très sensiblement le nombre de paysans sans terre, autre facteur de grande instabilité politique.
Certaines cités, comme Athènes avec Solon et Dracon, font alors appel à des législateurs, alors que dâautres ont recours à des aristocrates locaux, souvent chefs de guerre, qui vont instaurer la tyrannie.
Cette situation génère donc les deux grands phénomènes de cette période archaïque : la colonisation du bassin méditerranéen et la marche vers un système politique absolument nouveau dans le monde antique : la lente progression vers des formes de gouvernement démocratique.
| Chapitre précédent | Chapitre suivant |