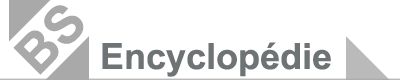Alsace : la maison alsacienne
5. Parcours régional
![]() La maison d’Alsace Bossue
La maison d’Alsace Bossue![]() La maison d’Outre Forêt
La maison d’Outre Forêt![]() La maison du pays de Hanau
La maison du pays de Hanau![]() La maison du Kochersberg
La maison du Kochersberg![]() La maison du Ried Nord ou Uffried
La maison du Ried Nord ou Uffried![]() La ceinture de Strasbourg et la Grande Plaine
La ceinture de Strasbourg et la Grande Plaine![]() La maison du Ried
La maison du Ried![]() La maison du Val de Villé
La maison du Val de Villé![]() La maison du vignoble
La maison du vignoble![]() La maison de la plaine de Haute Alsace
La maison de la plaine de Haute Alsace![]() La maison de montagne
La maison de montagne![]() La maison du Sundgau
La maison du Sundgau![]() La maison de la ville
La maison de la ville
5.11. La maison de montagne
 |
| L’auberge du Salm. (La maison alsacienne) |
La maison vosgienne se pr√©sente comme un b√Ętiment monobloc dont les trois locaux principaux, parall√®les (habitation, grange, √©table), ouvrent leurs portes respectives sur un ¬ę¬†usoir¬†¬Ľ (cour) au bord de la rue. L'homog√©n√©it√© apparente de cette maison ne doit pas faire illusion et il existe de multiples exceptions dues aux diverses influences des r√©gions avoisinantes¬†: Jura, Alsace bossue, plaine du nord et du sud, Lorraine, cette derni√®re √©tant pr√©pond√©rante.
Les fonctions économiques de cette maison sont relativement complexes : importance limitée des activités agricoles (agriculture de montagne, fromage), activités commerciales, artisanales ou industrielles (culture du chanvre et tissage), activités forestières… Les activités pastorales restent cependant dominantes. La transhumance se pratique sous sa forme la plus complète ; le rythme pastoral détermine la vie des hameaux ou villages, qui connaissent une activité saisonnière très marquée.
 |
| L’auberge du Seestaedtlé. (La maison alsacienne) |
Pour s'adapter au climat, la fa√ßade √©vite toujours l'orientation au nord, et souvent aussi celle de l'ouest d'o√Ļ viennent les vents pluvieux¬†; le mur expos√© √† l'ouest est toujours en pierre (¬ę¬†Wettersit¬†¬Ľ)¬†; les fen√™tres sont de pr√©f√©rence situ√©es sur la fa√ßade. La maison n'est cependant pas construite syst√©matiquement face au sud¬†: elle s'adapte √† la disposition du terrain de fa√ßon √† s'adosser √† la pente, ce qui lui permet de se prot√©ger des vents et facilite la mont√©e du fourrage aux portes d'engrangement du grenier. Les fermes d'√©levage, dispers√©es en montagne, pr√©sentent ainsi des orientations extr√™mement vari√©es¬†; au contraire, les fermes villageoises, construites face √† face, de part et d'autre d'une rue, suivant le cheminement d'une vall√©e, sont dispos√©es plus syst√©matiquement.
5.11.1. Matériaux et techniques de construction
Les mat√©riaux de la maison sont directement emprunt√©s √† l'environnement proche¬†: pierre, sable, bois, paille de seigle‚Ķ Le r√īle pr√©√©minent est jou√© par la pierre, principalement le gr√®s et le granit (au sud), plus rarement le calcaire (Jura alsacien). Le h√™tre est utilis√© comme bois de charpente et le ch√™ne sert √† la menuiserie. Le travail du bois est souvent grossier¬†; les poutres de la charpente sont fr√©quemment constitu√©es de troncs √† peine d√©grossis √† l'aide d'une hache sp√©ciale.
La disposition de la maison, basse, trapue, partiellement enterrée, a été conçue pour faire face aux intempéries. Les murs sont fondés directement sur la roche quand on rencontre le granit ou sur des fondations en béton. Lorsque la maison n'est pas enterrée, des murettes de soutènement à peu de distance des murs forment une plateforme artificielle. Ce dispositif garantit la solidité de la maison, et lui donne une forte inertie thermique, renforcée par l'épaisseur des murs du rez-de-chaussée (50 à 80 cm).
La pierre taill√©e se retrouve dans les soubassements et les cha√ģnages d'angle, les encadrements des fen√™tres, les linteaux, les appuis de fen√™tre, les marches du perron et de la cave, les encadrements des portes en saillie. Le reste est construit en moellons li√©s avec du b√©ton.
Les murs sont perc√©s d'ouvertures nombreuses, mais √©troites, pour √©viter toute d√©perdition de chaleur¬†; les fen√™tres √©vitent g√©n√©ralement le nord et l'ouest. Ces fen√™tres sont doubl√©es ou munies de volets pleins. L'√©tanch√©it√© et l'inertie thermique des murs sont renforc√©es par l'application de rev√™tements sur le mur du pignon ouest et parfois sur les parties sup√©rieures du mur de fa√ßade¬†: autrefois bardeaux, ¬ę¬†√©cailles¬†¬Ľ de sapin, r√©cemment des ardoises quadrangulaires, plaques de zinc galvanis√© ou panneaux d'√©ternit.
La toiture est assez fruste. La charpente est faite pour supporter une masse consid√©rable de la neige qui peut s√©journer plusieurs mois sur le toit. Assembl√©e √† tenons et mortaises avec des chevilles de bois, la ferme √† entrait retrouss√© se compose g√©n√©ralement de trois pannes¬†: une fa√ģti√®re, une sabli√®re et une panne courante au niveau de l'entrait¬†; elle porte sur les murs des pignons et sur les √©pais murs de refend et supporte le plancher du grenier √† foin. Les chevrons (rondins) sont assez √©pais et espac√©s de 60cm. Le voligeage est fait de lattes plus ou moins jointives selon le type de couverture utilis√©. Les pignons sont souvent tronqu√©s, d'un ou des deux c√īt√©s, par des demi croupes, diminuant la prise au vent. La pente des toits est forte et oscille entre 35¬į et 45¬į. Le mat√©riau traditionnel de couverture, la chaume a disparu depuis 1910, avec l'abandon de la culture du seigle. La petite tuile plate a √©t√© remplac√©e par les ardoises hexagonales de Belgique ou d'Angers, et plus r√©cemment par la tuile m√©canique, qui r√©siste bien au gel.
5.11.2. Description
 |
| Orbey en ¬ę¬†pays welche¬†¬Ľ¬†: maison alsacienne de type vosgien du Bas d‚ÄôOrbey. (La maison alsacienne) |
L'aspect trapu de l'ext√©rieur de la maison se poursuit √† l'int√©rieur, par l'exigu√Įt√© de pi√®ces d'habitation, propres √† la conservation de la chaleur humaine. Les pi√®ces sont en g√©n√©ral de faible hauteur (2 m sous plafond). A l'√©tage, lorsqu'il en existe, la hauteur est encore plus faible et un homme ne peut se tenir debout dans les soupentes. Au d√©but du XIX√®, cet √©tage sert d'ailleurs de r√©serve plut√īt qu'√† l'habitation. De nombreux rev√™tements de bois r√©chauffent les pi√®ces d'habitation¬†: plafonds aux poutres de ch√™ne apparentes rev√™tues de planches, plancher des chambres et des greniers, portes avec jambages, all√®ges des fen√™tres, plinthes, petits escaliers conduisant √† l'√©tage. Pour le chauffage, on combinait l'utilisation de l'√Ętre et celle du po√™le. L'√Ętre, plaque de pierre d'une vingtaine de centim√®tres d'√©paisseur, √©tait surmont√© d'un manteau de chemin√©e √† pans en biais, fix√© au plafond par un assemblage de poutres et de chev√™tres √† saut apparent.
La maison pr√©sente en fa√ßade sur la rue son c√īt√© le plus important, c'est-√†-dire le mur gouttereau. La taille de la maison s'√©value au nombre d'√©tages et au nombre de fen√™tres dispos√©es sym√©triquement sur la fa√ßade, c√īt√© habitation.
Bien que l'architecture des maisons vosgiennes se caract√©rise par une extr√™me sobri√©t√©, un ensemble de d√©tails d√©coratifs manifeste de fa√ßon ostentatoire la cat√©gorie sociale de leur constructeur¬†; les fermes ais√©es pr√©sentent ainsi des perrons plus hauts, des cha√ģnages d'angles √† harpes et besaces, des encadrements de porte et de fen√™tres en pierre alors que ces ¬ę¬†mat√©riaux nobles¬†¬Ľ sont parfois simplement imit√©s dans les maisons plus modestes par des motifs peints en rose. Dans les maisons ais√©es, les pierres assembl√©es par des joints en creux, sont orn√©es de courbes, d'arcs, de moulures qui n√©cessitent parfois la collaboration d'un tailleur de pierre. Dans ces diff√©rents √©l√©ments, on remarquera l'importance de la pierre taill√©e comme indicateur social.
La mani√®re dont on am√©nage la plate-forme (ou ¬ę¬†usoir¬†¬Ľ) qui s√©pare la maison de la rue, t√©moigne elle aussi du souci d'affirmer sa position sociale. Cet espace de circulation, d√©limit√© parfois vers l'avant par l'abreuvoir, pav√© dans les fermes importantes, toujours tr√®s ordonn√©, sert d'entrep√īt au fumier et au bois de chauffage, plac√©s l'un en face de l'√©table, l'autre en face de la maison d'habitation. Leur taille montre au passant l'importance du troupeau et de la famille.
Pour les agencements intérieurs, les maisons aisées, plus vastes, sont plus compartimentées. Le nombre des pièces permet une spécialisation plus nette des lieux affectés au sommeil et à la veille, une séparation plus claire des membres de la famille et des sous-groupes familiaux.
5.11.3. L’exploitation
Le portail ouvre sur la grange¬†: celle-ci est moins vaste que dans la plaine, mais on y range l'outillage encombrant (chars √† boeufs, schlittes)¬†; elle peut servir aussi d'aire de battage. La s√©paration des hommes et des b√™tes est toujours nette¬†: la grange s'ins√®re entre l'√©table et l'habitation, et chaque local poss√®de sa porte donnant vers l'ext√©rieur. Dans le cas le plus simple, on observe le sch√©ma suivant¬†: cuisine - grange - √©table. Dans le cas plus complexe¬†: cuisine - atelier d'hiver, d√©barras ‚Äď fromagerie, grange, √©table. Dans les fermes les plus cossues, un corridor s'intercale entre la cuisine et l'atelier d'hiver.
A l'étable ouverte sur le devant, s'opposent la porcherie et la basse-cour tournées vers l'arrière, sans communication directe avec l'habitation, rejetées avec les cabinets d'aisances dans des appentis que l'on n'atteint qu'en passant par la grange ou l'extérieur ; parfois le poulailler se trouve au fond de l'étable et les clapiers au fond de la grange.
5.11.4. L'espace habitation
La cuisine, pi√®ce de l'habitation la plus proche de l'ext√©rieur et des locaux de l'exploitation, est un lieu de travail sp√©cifiquement f√©minin¬†; la pierre y domine¬†: les pav√©s de gr√®s au sol, la pierre d'eau de l'√©vier et l'appui de la fen√™tre. Elle se divise en deux c√īt√©s¬†: √† l'avant, la pierre d'eau (l'√©vier) creus√©e dans un bloc de gr√®s, c'est le lieu de surveillance du terre-plein¬†; √† l'arri√®re, √† l'angle diam√©tralement oppos√© √† la porte, les feux. Sous le manteau de la chemin√©e s'alignent en effet la porte de chargement du po√™le, l'√Ętre, et, sur le mur perpendiculaire √† celui de la chemin√©e, la porte en fonte du four √† pain, √† vo√Ľte aplatie, qui empi√®te sur la pi√®ce mitoyenne. Au-dessus de la cuisine la ¬ę¬†pi√®ce √† lard¬†¬Ľ, est √©quip√©e d'un fumoir, armoire sans fond ni plafond, munie de claies et de crochets.
La ¬ę¬†chambre d'habitation¬†¬Ľ est elle aussi un lieu central de la vie commune¬†: ce lieu de travail domestique est vou√© dans la journ√©e aux travaux propres √† la femme (repassage, couture), ou aux petits travaux d'atelier de l'homme. L'exigu√Įt√© des lieux oblige parfois √† fixer au plafond des poulies et des cordes permettant de monter et descendre quelques outils¬†; ces poulies se situent en g√©n√©ral au-dessus du coin de travail des hommes dans l'angle avant, face √† la porte. Le coin du po√™le, diam√©tralement oppos√©, est encombr√© de s√©choirs √† vaisselle et √† linge, d'√©tag√®res suspendues aux poutres, parfois marqu√©es au nom de la m√®re. Cette pi√®ce est souvent destin√©e au sommeil, aux repas, surtout l'hiver, et √† la d√©tente.
Dans les autres parties de la maison, les hommes r√®gnent sur l'atelier o√Ļ, l'hiver, ils r√©parent les outils, fa√ßonnent les formes √† fromage. Les nombreux d√©barras o√Ļ sont entrepos√©es les r√©serves d'hiver sont le domaine des femmes. Un certain nombre de pi√®ces sont mixtes¬†: ainsi le fourneau de la buanderie sert aux femmes pour faire cuire les repas des b√™tes, bouillir la lessive, mais il est utilis√© aussi par les hommes pour distiller l'alcool des fruits.
5.11.5. Sous types et variantes
Il est possible d'opposer deux habitats vosgiens :
5.11.5.1. Au nord
Les maisons g√©n√©ralement petites, situ√©es au fond des vall√©es, sont serr√©es les unes contre les autres le long des rues des villages; elles sont construites en gr√®s, en terre et √† colombage pour certains murs. La toiture, g√©n√©ralement en tuile, est relativement peu pentue. Depuis le milieu du XIX√®, on trouvait souvent un m√©tier √† tisser dans les maisons¬†; actionn√© par le p√®re, il √©tait mont√© √† la lumi√®re dans l'angle avant droit de la salle commune¬†; les femmes et les enfants assis pr√®s du po√™le ou √† la cuisine travaillaient √† la canetteuse¬†; parfois, un petit b√Ętiment annexe √©tait destin√© √† cet usage.
La vie communautaire est tr√®s d√©velopp√©e dans les villages de tisserands-paysans, notamment dans ceux du Ban de la Roche gr√Ęce particuli√®rement √† l‚Äôaction du pasteur Oberlin √† partir de la fin du XVIII√®.
5.11.5.2. Au sud
 |
| Orbey en ¬ę¬†pays welche¬†¬Ľ¬†: maison alsacienne de type vosgien du Bas d‚ÄôOrbey. Fa√ßade sud. (La maison alsacienne) |
Le tableau est composite¬†: au village se substituent plus nettement des hameaux. Les exploitations tendent √† se disperser et √† se rapprocher de leurs terres¬†: elles s'√©l√®vent sur le bord d'un chemin¬†; dans les hameaux, elles sont s√©par√©es les unes des autres pour √©viter la propagation des incendies dans les toits de chaume, pentus et couverts de paille de seigle longue tombant √† hauteur d'homme¬†: c‚Äôest le cas des grandes maisons, caract√©ristiques du Val d'Orbey et de la vall√©e de Kaysersberg, des constructions plus m√©ridionales ainsi que des ¬ę¬†fermes d'altitude¬†¬Ľ.
Les premi√®res sont de taille imposante¬†; ce sont souvent d'anciennes m√©tairies d'abbayes r√©cup√©r√©es par les cultivateurs √† la R√©volution. Il s‚Äôagit de fermes d'√©levage et de fromageries. L‚Äô√©table est imposante et comporte une rigole centrale entre deux trottoirs¬†; La fontaine prend beaucoup d'importance et est fr√©quemment abrit√©e dans la remise¬†; la fromagerie est une pi√®ce chauff√©e toute l'ann√©e √† temp√©rature constante (28¬į) au moyen d'un po√™le aliment√© √† partir de l'atelier, situ√© sur l'avant de la maison. Cet atelier, o√Ļ tous les membres de la famille ex√©cutent les premi√®res phases de la fabrication du fromage, du caillage √† l'√©gouttage, est reli√©e √† l'atelier et √† la cave √† fromage¬†; En raison de sa chaleur constante, la fromagerie remplace √† certains moments de l'ann√©e la salle commune, et sert de salle de r√©union.
Dans les vall√©es plus industrialis√©es, et dans celles situ√©es plus au sud, les b√Ętiments tendent √† se disjoindre et les maisons sont souvent disparates¬†; les exploitations situ√©es vers l'ouest, sur les hauteurs, contrastent fortement avec celles des basses vall√©es¬†; les premi√®res apparaissent comme une forme rudimentaire de la maison vosgienne (murs en grosses pierres mal taill√©es, petites ouvertures, enfoncement des √©tables dans le sol, absence d'√©tages. Dans les basses vall√©es, au contraire, les maisons s'apparentent √† celles de la plaine et se parent de hauts perrons et de nombreuses galeries. Les exploitations du Val de Saint-Amarin sont plus spacieuses, mais n'ont plus la puret√© de lignes des grandes fermes du Val d'Orbey¬†; la toiture tend √† se diviser en deux parties, et, du dehors, l'habitation se distingue des locaux d'exploitation. L'entr√©e se trouve sur le c√īt√©.
 |
| Traubach le Bas (secteur de Masevaux)¬†: ferme-bloc du XVI√® avec structure √† ¬ę¬†poteau de fond¬†¬Ľ et panne fa√ģti√®re. (La maison alsacienne) |
Les formes les plus frustes d'habitat se rapprochent enfin de celles des marcairies, habitats d'√©t√© des troupeaux¬†; ces exploitations install√©es sur la ligne des cr√™tes, au-dessus des vall√©es du Haut-Rhin jusqu'√† la vall√©e de Masevaux, ont longtemps appartenu aux communes qui les louaient l'√©t√© aux marcaires (de l‚Äôallemand ¬ę¬†Melker¬†¬Ľ, celui qui est charg√© de la traite des vaches) avec les chaumes¬†; ceux-ci y montent encore en mai avec leur famille et leur mobilier¬†; l'organisation de ces maisons a √©t√© pr√©vue en fonction de l'√©levage. La grange est remplac√©e par une laiterie¬†; dans les maisons les plus modestes, les b√™tes et les gens y demeurent ensemble, s√©par√©s par des portes situ√©es √† droite et √† gauche de la laiterie.
Parfois, l'espace traditionnel de la grange est compl√®tement ouvert sur le devant, ce qui coupe le mur du b√Ętiment en deux, mais non la toiture. Un pr√©au interm√©diaire est ainsi m√©nag√© entre la cuisine et l'√©table, et il abrite la fontaine. L'√©table, o√Ļ les b√™tes ne rentrent que pour la traite pendant les grandes chaleurs, est tr√®s allong√©e¬†: elle communique avec la fromagerie o√Ļ l'√Ętre a √©t√© tr√®s longtemps maintenu (le feu ne devait pas s'√©teindre sous peine de porter malheur). A l'arri√®re de la maison, la cave √† fromage est un r√©duit sombre et frais o√Ļ les fromages sont conserv√©s √† l'abri des mouches. Le toit de la maison est peu pentu¬†; sous ses bords les fromages de Munster s√®chent au vent.
5.11.6. A voir dans la montagne
5.11.6.1. Haut Rhin
- Aubure¬†: fermes vosgiennes de type ¬ę¬†maison-blocs¬†¬Ľ. Le village a √©t√© d√©truit lors de la guerre de Trente Ans.
- Le Bonhomme : grandes fermes caractéristiques de la montagne vosgienne.
- Cernay¬†: ville en grande partie d√©truite en 1914 - 1915 et sinistr√©e une nouvelle fois en 1945. Il subsiste n√©anmoins quelques immeubles anciens dont la ¬ę¬†Porte de Thann¬†¬Ľ (XIII√® si√®cle) √† triple √©tage de colombage.
- Echery¬†: Habitat de type ¬ę¬†vosgien¬†¬Ľ. Ancienne prison des mineurs (XVI√® si√®cle).
- Labaroche¬†: village de montagne √† l'habitat tr√®s dispers√© (une quarantaine de hameaux). Fermes du type ¬ę¬†maison-bloc¬†¬Ľ reconstruites pour la plupart apr√®s la Deuxi√®me Guerre mondiale.
- Munster¬†: ville industrielle √† l'entr√©e le la vall√©e du m√™me nom. Ancienne halle aux grains (la Laub) de 1503 transf√©r√©e en un autre endroit au XIX√® si√®cle. H√ītel de ville (1550) de style Renaissance (restaur√©).
- Orbey¬†: belles fermes vosgiennes traditionnelles dans cette commune francophone de montagne, √† l'habitat fortement dispers√© (quarante hameaux o√Ļ vit pr√®s de la moiti√© de la population). Les fermes isol√©es occupent g√©n√©ralement d'anciennes m√©tairies de l'abbaye de Pairis, ravag√©e lors de la guerre des Paysans en 1525.
- Dolleren : anciennes maisons paysannes.
- Rombach le Franc¬†: village ¬ę¬†vosgien¬†¬Ľ classique. Nombreuses fermes dispers√©es en hameaux.
- Sainte Croix aux Mines : maison à pignon du XVIè siècle avec deux tourelles d'escalier. Plusieurs maisons en pierre des XVIIé et XVIIIè siècles
- Thann : ancienne Halle-aux-Blés Renaissance (XVIè siècle). Musée des Arts et Traditions Populaires, maisons anciennes XVIIè siècle, certaines à oriels.
 |
| Aubure : une ferme typique des Hautes Vosges. (La maison alsacienne) |
 |
| Orbey : le Val supérieur. (La maison alsacienne) |
|
|
|
5.11.6.2. Bas Rhin
- Ban de la Roche ‚Äď Bellefosse¬†: maisons-blocs de type vosgien (XVIII√® - XIX√® si√®cles) avec auvents importants et portes de grange cintr√©es. Oculi en pierre de taille de forme vari√©e. Mus√©e Oberlin √† Waldersbach.
- Cosswiller : Village entièrement détruit lors de la guerre de Trente Ans et reconstruit par les immigrants. Colombage apparent à certains étages.
- Grandfontaine : ancienne commune minière comptant plusieurs hameaux. Architecture classique de la montagne vosgienne. Maisons forestières.
- Grendelbruch : village typique de montagne. Plusieurs hameaux et nombreuses fermes isolées. Maisons forestières.
- Le Hohwald : maisons traditionnelles de montagne. Etables et fenil regroupés sorts le même toit que le logis.
- Klingenthal¬†: fusionn√© avec Boersch. La commune eut sa p√©riode de gloire au d√©but du XIX√® dernier gr√Ęce √† ses nombreuses et excellentes forges fabriquant des armes blanches (Klingen) r√©put√©es. Un embl√®me professionnel de forgeur d'armes (1818) √† Ottrott, √† l'entr√©e de la vall√©e, en rappelle le souvenir. Certaines forges √† pilon hydraulique ont encore fonctionn√© jusque vers 1950.
- Plaine¬†: maisons le style ¬ę¬†vosgien¬†¬Ľ. Linteaux orn√©s.
- Romanswiller : Maisons (XVIIIè) avec rez-de-chaussée en pierre et étages à colombage. Moulins et lavoirs sur la Mossig. Enseignes d'auberge.
- Wisches¬†: Maisons traditionnelles du style ¬ę¬†vosgien¬†¬Ľ.