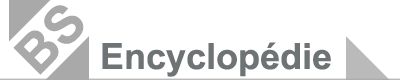|
|
Alsace : lâart roman en Alsace
2. Lâart roman en Alsace  Généralités Généralités
 Architecture Architecture
 Sculpture Sculpture
 Peinture, enluminure et vitrail Peinture, enluminure et vitrail
 Objets dâart : ferronnerie et orfèvrerie Objets dâart : ferronnerie et orfèvrerie
 | | Carte de lâAlsace romane |
2.3. SculptureLa sculpture romane, étroitement liée à l'architecture, n'a pas connu en Alsace le foisonnement qu'on lui connaît dans les grands centres tels que la Bourgogne ou la Provence, par exemple, sans doute par modestie de conception et de moyens. Mais sa séduction n'en est pas moindre ; elle a fait l'objet de nombreuses études particulières ou bien a été signalée dans l'ouvrage fondamental de R. Kautzsch, « Der romanische Kirchenbau in Elsass » (Fribourg. 1944). Mais c'est le mérite de R Will d'en avoir dressé l'inventaire exhaustif dans son « Répertoire de la Sculpture romane en Alsace » (Revue d'Alsace 1957), dégagé les particularités et les programmes iconographiques et proposé au bout de son étude la synthèse : « lâArt roman en Alsace ». C'est ainsi que plus d'une centaine d'édifices ou lieux de provenance d'Åuvres conservées dans les collections publiques ou privées ont été relevés et des ateliers définis selon leur style.
Certaines pièces, du fait de l'imprécision de leur provenance ou du caractère particulièrement fruste de leur facture ou de leur état de conservation constituent des témoignages isolés d'époques plus lointaines. 2.3.1. Les premières Åuvres (IXè-XIè)Les premières Åuvres les plus remarquables, très éparses, sont encore de facture relativement frustes. La rareté des Åuvres de haute époque, et leur manque de contexte empêchent de tenter une synthèse. A signaler :
- le tombeau à médaillons et frise d'entrelacs du sarcophage des moines de Murbach massacrés par les Hongrois en 939, de facture carolingienne ;
 | | Murbach : détail du sarcophage des moines massacrés par les Hongrois au Mordfeld |
|
- le tombeau de Bereswinde et d'Adalric au couvent du mont Sainte Odile (anciennement Hohenbourg), du XIè ;
- les premiers chapiteaux de la crypte de la cathédrale de Strasbourg, aux corbeilles ornées de monstres et de rinceaux noués ;
- les chapiteaux de la chapelle Saint Sébastien de Neuwiller lès Saverne.
- l'Agnus Dei en réserve dans un médaillon sous l'arc de décharge de l'église d'Altenstadt, que l'inscription de la tablette de couronnement faisant mention de l'abbé Liuthard de Wissembourg (1002-1032) date parfaitement.
 | | Altenstadt: linteau et tympan du portail dâentrée provenant sans doute de Wissembourg |
- le couvercle de sarcophage à arcade géminée et à rosaces de Bergholtz (Haut-Rhin), XIè siècle.
- le linteau à figures allégoriques d'un jardin du Paradis, provenant de la porte méridionale de l'église de Bergholtz-Zell, vers 1049.
2.3.2. Les grandes Åuvres du XIIèLe XIIè siècle est la grande époque de la sculpture romane d'Alsace, auquel appartiennent la majorité des ensembles. Ainsi les principales Åuvres, dans lâordre chronologique : 2.3.2.1. Sainte-Sophie d'Eschau et son atelierLes vestiges du cloître de Saint Trophime et Sainte-Sophie d'Eschau, (vers 1130) constituent le plus bel ensemble de chapiteaux sculptés de lâAlsace romane, nettement influencé par le grand centre de Saint Trophime d'Arles, maison - mère des bénédictines établies à Eschau. Quelques arcades du cloître sont reconstituées au musée de lâÅuvre Notre Dame, alternant colonnettes simples et colonnettes jumelées. Les tailloirs y présentent des bas reliefs sculptés en méplat, avec des traces de peinture, racontant des scènes de la vie du Christ, de l'Annonciation à la visite des trois femmes au tombeau, des sujets allégoriques ou tirés de récits (scène galante - Didon et Enée ? dont une cigogne aux apparences d'ibis) avec motifs de palmettes.
 | | Eschau : chapiteau du cloître. Strasbourg, musée de lâÅuvre Notre Dame |
|
 | | Eschau : cloître. Strasbourg, musée de lâÅuvre Notre Dame |
|
A cette série s'ajoute une cuve baptismale, très mutilée, dont les flancs portent sur deux registres des scènes de la vie et de la passion du Christ jusqu'à la Pentecôte.
A ce même atelier appartient sans doute le sarcophage de l'évêque Adeloch de Saint Thomas de Strasbourg, hormis le couvercle, plus tardif. Portée par quatre lions couchés, la cuve est décorée d'une arcade quâoccupent, sur les deux faces principales, un Christ assisté d'un ange bénissant l'évêque agenouillé et une figure allégorique représentant l'Eglise ou une Vertu accompagnée de rinceaux et de palmes. Sur les petits côtés, le roi remet le gonfanon à l'évêque agenouillé qu'une femme quelque peu énigmatique lui présente.
 | | Strasbourg, saint Thomas: le sarcophage dâAdeloch |
|
 | | Strasbourg, saint Thomas : détail du sarcophage dâAdeloch : le Christ bénissant |
|
 | | Strasbourg, saint Thomas : détail du sarcophage dâAdeloch |
|
2.3.2.2. Sainte Richarde dâAndlauDeux cycles sont présents sur les reliefs de lâabbatiale Sainte Richarde dâAndlau, créés par l'un des ateliers les plus féconds des années 1140-1150.
Le premier, d'une facture plus sommaire et d'un relief plus accusé est constitué dâune frise historiée de près de 30 mètres, qui parcourt en hauteur le massif occidental. La frise représente des animaux naturels et fantastiques, des hommes chasseurs ou guerriers, diverses scènes de banquets⦠On y reconnaît entre autres Théodoric et Hildebrand délivrant le chevalier Sintram, selon l'épopée de Théodore de Ravenne (dâoù une influence lombarde). La signification symbolique en reste cependant difficile à saisir.
 | | Andlau, abbatiale sainte Richarde: chameau de la frise extérieure |
|
 | | Andlau, abbatiale sainte Richarde: détail de la frise extérieure |
|
Le second cycle orne de bas-reliefs l'arcade et les chapiteaux du porche ainsi que le portail de l'église, son tympan, son linteau et ses piédroits. La clef de voûte du porche, pièce significative par excellence, représente l'acte de donation de l'abbaye au Christ par l'impératrice Richarde. En haut-relief David et Samson combattent lâun Goliath et lâautre le lion, préfigurant la victoire du Christ sur la mort. Au tympan, le Christ remet la clef à Saint Pierre et le Livre à Saint Paul, entre deux scènes de chasse. Au linteau est contée l'histoire d'Adam et dâEve, avec la déclinaison de la symbolique de lâarbre : arbre de vie, arbre de la Connaissance du bien et du mal, « arbre sec » légendaire. Aux jambages, sous cinq arcatures superposées, des couples de bienfaiteurs de l'abbaye. Aux chapiteaux, la symbolique paléochrétienne des oiseaux se désaltérant.
 | | Andlau : détail du porche de lâabbatiale : la création dâEve |
|
 | | Andlau : détail du piédroit du portail de lâabbatiale : décors floraux avec animal |
|
 | | Andlau : détail du bas relief du portail |
|
Enfin, au croisillon sud du transept un bas-relief représente le Christ avec Irmengarde, donatrice ou abbesse. 2.3.2.3. LautenbachCâest dans lâélégant porche de Lautenbach, (1140 et 1150), que la sculpture romane dâAlsace est la plus séduisante :
- Le tympan a été martelé, mais des traces révèlent un Christ dans sa mandorle entre un saint Michel au dragon à gauche et saint Gangolphe en armes à droite.
- La frise de lâimposte se lit de l'intérieur vers l'extérieur : Sur le jambage gauche, une femme portant un enfant est en butte aux avances d'un homme nu ; une bête aux longues oreilles symbolise le tentateur. Suivent l'homme et la femme enlacés, puis le mari battant sa femme qui tombe avec l'enfant ; enfin l'enfant couché sous un serpent, l'homme nu ouvrant la gueule du monstre. Sur le jambage droit, deux groupes d'hommes enlacés, un homme faisant voltiger un enfant dans chaque main, l'un enlacé par un serpent, l'autre mordu par un porc. Cette brute ricanante est l'image du maître des Enfers, tout comme le tricéphale de Marmoutier.
 | | Lautenbach : chapiteau du porche |
- Le sens de ces scènes n'est pas très clair. La représentation de l'adultère est sans doute en relation avec les fonctions de saint Gangolphe, les scènes démoniaques pouvant se rattacher au cycle de Saint Michel.
 | | Lautenbach : chapiteau du porche |
- Enfin, à l'angle sud-ouest du porche une sculpture mérite attention : deux personnages en un jardin, habillés et chaussés, représentent les élus en possession du fruit du Paradis. On retrouve cette scène au portail de l'église franciscaine de Salzbourg et dans passablement de miniatures (Manuscrits de l'école de Thuringe).
 | | Lautenbach: Frise sculptée. Détail du porche de lâéglise |
2.3.2.4. AlspachLes sculptures de l'abbatiale d'Alspach près de Kaysersberg datent même époque, lâéglise étant consacrée en 1149. Elles présentent deux ensembles :
 | | Le prieuré dâAlspach dâaprès une gravure du XVIIIè. Lithographie dâEngelmann |
- celui du sculpteur du portail inspiré du bestiaire et présentant des sujets allégoriques
- celui du sculpteur des consoles historiées, conservées au musée d'Unterlinden de Colmar et représentant entre autres le sein d'Abraham ou la communion de Marie l'Egyptienne.
 | | Chapiteau du XIIè provenant dâAlspach et conservé au musée dâUnterlinden à Colmar |
2.3.2.5. Saints Pierre et Paul de RosheimA Saint Pierre et Saint Paul de Rosheim, comme à Murbach, on ressent lâinfluence de lâItalie du nord dans lâÅuvre sculptée :
- sur la façade ouest, le combat de la mort et de la résurrection est symbolisée par la présence des lions d'acrotères asservissant les hommes et le saint Pierre et l'aigle (fleuron terminal) montrant le chemin du salut. Le portail et la niche montraient jadis le Christ en majesté dans sa mandorle portée par les anges et la Crucifixion.
 | | Rosheim: saints Pierre et Paul : sculptures |
- le tympan de la porte du côté sud a été martelé, mais lâencadrement du portail et ses ébrasements sont d'une grande richesse ornementale (grecques, piastres, chevrons et têtes d'animaux).
- corniches, pignons du transept et rampants des toits sont riches de figuration d'animaux, dragons et hommes (l'ours au gâteau de miel), alors quâautour de la fenêtre d'abside se trouvent les symboles des Evangélistes.
 | | Rosheim : Personnage à la retombée du clocher du transept |
|
- à l'intérieur les sculptures ornent culots et chapiteaux de personnages et faces grotesques dont le chapelet de têtes (sans doute de moines) de lâune des colonnes, dâune incommensurable drôlerie.
2.3.2.6. DorlisheimA l'église protestante de Dorlisheim, des masques grimaçants d'où s'échappent des rinceaux de vigne, et des dragons ailés occupent le tympan du portail ; aux contreforts le lion de saint Marc et une figuration du thème de la chasse.
 | | Dorlisheim : sculptures du chevet |
A l'intérieur, chapiteaux et bas reliefs proposent des monstres aquatiques et sans doute la réception d'Abraham par Melchisédech et le roi de Sodome.
Lâensemble a été réalisé sans doute vers 1150.
 | | Dorlisheim : sculptures du chevet |
2.3.2.7. Sainte Foy de SélestatLe cas de Sainte-Foy de Sélestat est particulier. Avec ce chantier de la seconde moitié du siècle (1160ss) se fait sentir lâinfluence lorraine qui apparaît aussi dans la figuration mi-humaine, mi-monstrueuse ou animale : lions couchés portant des colonnettes, aigles léonins, dragons et chimères, masques et serpents, béliers - sirènes, cerfs et taureaux, scènes de genre mais aussi symboles des Evangélistes ornent lâédifice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
 | | Sélestat : Sainte Foy: le portail |
|
 | | Sainte Foy de Sélestat : détail du chevet |
|
Cette inspiration se retrouve, sous le même ciseau, dans les chapiteaux de l'église de Lièpvre (aujourdâhui socles des fonts baptismaux) et dans les chapiteaux des piliers du carré du transept de Sainte Richarde d'Andlau.
 | | Sainte Foy de Sélestat : Tympan de portail |
|
 | | Sainte Foy de Sélestat : chapiteau du porche |
|
 | | Sélestat, église sainte Foy. Lion du porche |
|
2.3.2.8. Åuvres diverses
- A Sigolsheim (fin du XIIè), le portail reprend le thème de la remise par le Christ des clefs à saint Pierre et du Livre à saint Paul avec les donateurs agenouillés, dont l'un porte le nom d'Ulrich. Au linteau, cinq médaillons portent l'Agneau de Dieu, les symboles des Evangélistes et un ange assis sur un escabeau. A l'intérieur comme à l'extérieur, l'habituel monde de figures humaines et d'animaux plus ou moins fantastiques ainsi que des motifs géométriques.
 | | Sigolsheim : chapiteau de lâéglise romane |
|
 | | Sigolsheim : chapiteau de lâéglise romane |
|
 | | Sigolsheim : chapiteau du porche |
|
 | | Sigolsheim : le tympan de lâéglise romane |
|
- Saint Léger de Guebwiller se situe dans la même lignée, avec la théorie habituelle des êtres hybrides, grotesques et allégoriques, mais avec, sous le porche un portail dont les piédroits sont remarquablement ornés et encadrent un tympan où figure le Christ bénissant entre saint Léger et la Vierge couronnée.
 | | Guebwiller : console du portail de Saint Léger |
|
 | | Guebwiller: saint Léger. Sculptures : tympan, portail |
|
- A l'orée du XIIIè siècle, suite à la dernière campagne de décoration de la cathédrale romane de Strasbourg, vers 1190, apparaissent les premiers signes de la transition entre le monde roman et les approches du gothique qui donneront naissance au célèbre « pilier des anges ».
 | | Strasbourg, cathédrale : le célèbre pilier des anges, Åuvre de transition roman-gothique |
|
 | | Strasbourg, cathédrale : le célèbre pilier des anges. Vue du transept sur le chÅur |
|
 | | Strasbourg, cathédrale : le célèbre pilier des anges |
|

Articles connexes
|
|
![]() Généralités
Généralités![]() Architecture
Architecture![]() Sculpture
Sculpture![]() Peinture, enluminure et vitrail
Peinture, enluminure et vitrail![]() Objets dâart : ferronnerie et orfèvrerie
Objets dâart : ferronnerie et orfèvrerie