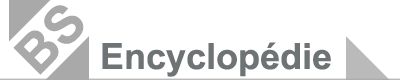Nazisme : les opérations « T4 » et « 14F3 » (2ième guerre mondiale 1939-1945)
2. Prémisses : de lâeugénisme à l'euthanasie étatique : lâhygiène raciale
![]() Lâeugénisme (Eugenik) ou « hygiène raciale » (Rassenhygiene)
Lâeugénisme (Eugenik) ou « hygiène raciale » (Rassenhygiene)![]() Une autre problématique : l'euthanasie
Une autre problématique : l'euthanasie![]() Eugénisme et euthanasie des nouveau-nés infirmes
Eugénisme et euthanasie des nouveau-nés infirmes![]() La psychiatrie au service du projet hitlérien
La psychiatrie au service du projet hitlérien![]() Lâengagement des psychiatres, biologistes et médecins au coté du pouvoir
Lâengagement des psychiatres, biologistes et médecins au coté du pouvoir
L'euthanasie de plus de 150 000 patients allemands dans le cadre des opérations T4, lâAktion Brandt et 14f13 a pu se dérouler sans difficultés sur le plan médical, grâce à la collaboration, à l'adhésion ou à la tolérance de la majorité des psychiatres et du corps médical allemand, sans lesquelles elle n'aurait pas été possible. Aucun psychiatre ni médecin n'a jamais été obligé de participer directement aux différentes actions d'euthanasie : il ne s'agissait pas d'un « ordre » (Befehl) mais d'une « autorisation » (Ermächtigung) avec dotation de « pleins pouvoirs » (Vollmacht). Mais nombreux sont les scientifiques qui se jettent sur les « matériaux humains » fournis par l'euthanasie : non seulement des cerveaux, mais aussi des victimes encore vivantes servant de matériel dâexpérimentation avant dâêtre éliminées⦠A commencer par les «chercheurs » des deux plus prestigieux instituts allemands, l'Institut Kaiser-Wilhelm de Recherche sur le Cerveau de Berlin et l'Institut Allemand de Recherche Psychiatrique de Munich. Les cas de résistance de la part des médecins et psychiatres ont été extrêmement rares. T4 ne fut donc en aucun cas le fait de quelques SS sadiques, médecins illuminés ou « pseudo-scientifiques », illuminés, mais de l'ensemble de la profession psychiatrique, de psychiatres normaux, habituels et représentatifs de leur science.
 |
| Le Kaiser-Wilhelm Institut de Berlin, fondé en 1912. Haut lieu de Science⦠mais pas toujours de Conscience |
Les psychiatres furent massivement impliqués et jouèrent un rôle considérable dans la « biocratie » du IIIè Reich et le bilan est effrayant, allant des 360 000 stérilisations de malades « héréditaires » (96% des stérilisés sont des patients psychiatriques) à lâ« euthanasie sauvage » de psychotiques jugés « incurables » et handicapés mentaux, euthanasie laissée à la libre initiative des psychiatres ayant pleins pouvoirs, en passant par la castration des homosexuels, la déportation des « asociaux », l'extermination des criminels et des Tziganes⦠Câest le professeur Ernst Rüdin et ses collaborateurs de l'Institut Allemand de Recherche Psychiatrique (actuel Max-Planck Institut für Psychiatrie) qui légitiment scientifiquement la loi sur lâeugénisme (6 des 8 maladies entrant dans le cadre de cette loi relèvent du secteur psychiatrique) ; la presque totalité des professeurs de psychiatrie siège dans les « Tribunaux de santé héréditaire » statuant sur les stérilisations ; l'un des principaux artisans de la loi sur le mariage est le professeur de psychiatrie Weygandt ; la direction scientifique du « traitement » des homosexuels est confiée à un psychiatre, le docteur Rodenberg, par ailleurs expert de lâopération T4 ; le sort des « asociaux » et des criminels dépend des travaux et décisions communs entre les services de police et les psychiatres généticiens spécialisés en « biologie criminelle », alors que le responsable scientifique de l'extermination des Tziganes est le pédo-psychiatre-généticien R. Ritter⦠Ainsi la « banalité du mal » s'intègre elle aussi sans heurt dans la « normalité psychiatrique » et le « quotidien médical banal » (Alltägliche Medizin).
Chaque hôpital psychiatrique, chaque université, chaque institut de recherche est concerné et participe, qu'un tel degré de collusion ne pouvait pas être « uniquement le fruit de l'égarement de quelques individus, mais qu'il avait pour origine des défaillances de la psychiatrie (â¦) elle-même » (Benno Müller-Hill). La dictature politique seule, pas plus que la psychopathologie de tel ou tel, ne suffisent à expliquer tout ce qu'ont fait les psychiatres, médecins et chercheurs. Si le crime a été possible, câest que la science psychiatrique lâa rendu possible, par une lente dérive remontant bien avant lâapparition du nazismeâ¦
2.2. Une autre problématique : l'euthanasie
Ce qui vaut pour lâeugénisme est loin de sâappliquer à lâeuthanasie avant 1933. Si le débat sur lâeugénisme est pratiquement réglé et aurait sans doute fait lâobjet dâune loi sans le nazisme, la question de l'euthanasie reste encore relativement confidentielle entre 1913 et 1933 : moins d'une dizaine de psychiatres (dont une bonne moitié contre) et à peine plus d'autres médecins non psychiatres prennent publient leur opinion sur l'euthanasie avant 1933.
Comparativement, la défense de l'euthanasie en Allemagne avant 1933 mobilise, sur le plan professionnel, surtout des juristes et des psychiatres. Les acteurs médicaux de l'euthanasie des années 1939-1945 sont essentiellement des psychiatres, des pédiatres et de très jeunes médecins « idéalistes » et sans spécialité. Professionnellement, le champ d'intersection entre eugénisme et euthanasie concerne donc en premier lieu la psychiatrie.
En 1921, l'assemblée des médecins allemands rejette encore à l'unanimité un projet de loi autorisant la « suppression des vies indignes d'être vécues ». Sous la république de Weimar, le terme « euthanasie » possède deux significations principales :
- la « Sterbhilfe », ou « aide à la mort », où l'euthanasie consiste à accélérer la mort d'un malade conscient affecté d'une maladie incurable, qui la réclame lui-même ;
- la « suppression des vies indignes d'être vécues » au nom de l'intérêt collectif, notion qui débouchera sur la suppression des malades et handicapés mentaux « incurables » sous le nazisme.
Le débat sur lâeuthanasie oppose alors trois grandes tendances :
- Celle des adversaires de toute forme d'euthanasie, généralement religieux : 'homme n'a pas à se substituer à Dieu ;
- Celle des partisans de l'élimination « étatique » des handicapés mentaux, comme le professeur Hoche ;
- Celle des partisans de « l'aide à la mort », mais résolument opposés à l'euthanasie des handicapés qui ne le demandent pas.
A ce moment, euthanasie et eugénisme ne sont pas liés : de tous les arguments avancés pour l'euthanasie au nom de l'intérêt collectif, aucun ne se réclame généralement ni ne relève directement de l'eugénisme. Les deux arguments majeurs et récurrents de l'euthanasie au nom de l'intérêt collectif ressortent plutôt de l'évaluation bio-médicale du niveau d'humanité d'un individu et du coût économique « faramineux » des « existences fardeaux » (« Ballastexistenzen ») pour la collectivité. D'ailleurs, dans le langage des psychiatres nazis, l'euthanasie des adultes s'appelle « mesure de planification économique » et non « mesure d'hygiène de l'hérédité ». Dans la pratique, le critère le plus important nâest pas l'éventuelle propagation d'une maladie héréditaire, mais la curabilité, l'aptitude au travail et la productivité des patients.
 |
| Extrait dâun document statistique de Hartheim retrouvé par les Américains en 1945. Il fait état de gains réalisés par lâétat allemand grâce à la « désinfection » de 70 723 handicapés lors de T4 |
Dâailleurs les principaux partisans de lâeugénisme se prononcent en général contre lâeuthanasie : câest le cas du professeur Rüdin qui en 1923 se prononce contre l'euthanasie des vies « sans valeur » mais « dotées de sentiments » ; en 1931, le psychiatre-généticien Luxemburger, principal collaborateur de Rüdin, publie un catalogue des mesures « psychiatriques-eugénistes » où il condamne comme « indigne d'un peuple civilisé l'euthanasie des âvies indignes d'être vécuesâ » et rappelle « le respect inconditionnel de la vie de l'être humain » ; en 1933 même l'anthropologue hygiéniste racial nazi L. Loeffler condamne lâeuthanasie, ou encore le professeur Karl Bonhoeffer (1868-1948), dont deux fils résistants seront exécutés par les nazis.
 |
| Le professeur Karl Bonhoeffer et son épouse Paula |
Tous par contre sont unanimes à vouloir la mise en place dâune politique eugéniste et approuveront la Loi de stérilisation promulguée par le gouvernement de Hitler en juillet 1933, la considérant comme une « étape importante dans la thérapie psychiatrique » du point de vue de la « prophylaxie » (Karl Bonhoeffer).